Anna Hope ouvre son roman La salle de bal (traduit de l’anglais par Elodie Leplat) sur un bref prologue situé en Irlande en 1934. Par « une belle et douce journée », une femme marche vers une maison, aperçoit un homme en haut d’une échelle, l’observe en hésitant, puis marche vers lui en disant son nom.

High Royds Hospital - Menston Asylum (YouTube), qui a inspiré l'asile de Sharston dans le roman
Retour en 1911 : le récit commence à l’opposé de cette douceur. Ella Fay, une jeune Irlandaise, se retrouve dans un endroit inconnu qui n’est pas la prison à laquelle elle s’attendait. Des femmes en uniforme, un dortoir, d’autres femmes qui radotent ou geignent, personne à qui parler vraiment, sauf cette « grande fille pâle » qui s’assied près d’elle au petit déjeuner : Clem lui explique ce qui se passe autour d’elle à l’asile de Sharston.
Ella sait que c’est un endroit pour les aliénés, pour les pauvres. Elle n’est pas folle : elle a juste cassé une fenêtre à la filature où elle travaille depuis ses huit ans. Le Dr Charles Fuller la convoque pour compléter son dossier d’admission. Ella vivait avec son père, sa mère est morte. Ella se dit prête à rembourser les dégâts, frappe la table en le voyant écrire sans lui répondre – il note « pulsions violentes » et appelle les infirmières. La jeune femme leur échappe et s’encourt dehors où elle aperçoit deux hommes « debout dans un trou » avant de glisser dans la boue et d’être emmenée de force. L’un des deux lui avait tendu la main : « Hé, ça va ? »
La romancière alterne trois points de vue : celui d’Ella, celui de John (la main secourable), celui de Charles, un des médecins. John Mulligan travaille avec Dan Riley, qui l’a pris sous son aile, à creuser des tombes sous la surveillance de Brandt, un Anglais brutal. Dan, ancien marin, n’est jamais à court d’histoires ou de chansons. Les hommes et les femmes vivent séparément à l’asile, sans se voir. Aussi les deux amis se sont réjouis de la cavale d’Ella : « Une sauvagerie en elle. Une liberté. Qui vint se planter dans le ventre de John et lui vriller les tripes. » Il lui a tendu la main, avant que Brandt l’attrape et lui tire les bras dans le dos.
Le Dr Charles Fuller est aussi musicien. Il défend auprès du directeur le rôle thérapeutique de la musique pour les patients – « Mozart pour les épileptiques. Ou Bach. Les patients semblent apprécier l’ordre que cette musique leur procure (…) ». Lui préfère entre toutes la musique pour piano seul, dirige l’orchestre. Le directeur l’interroge sur la fille qui a tenté de fuir ; il ne veut plus d’évadés, cela nuit à la réputation de l’asile. Quand Fuller annonce qu’il aimerait préparer une allocution pour le Congrès international de la Société d’éducation eugénique, il le rabroue et le renvoie à ses fonctions.
Charles travaille à l’asile depuis cinq ans, cet emploi lui a permis d’échapper à ses parents, indifférents à son amour de la musique. En faisant le tour des patientes, il interpelle Clem, toujours à lire dans ses moments libres, ce qu’il juge nuisible, puis s’installe au piano. Chez les hommes, en jouant un Impromptu de Schubert, il voit que John Mulligan est sensible à la musique. Le vendredi soir, il y a un bal réservé à ceux et celles qui se sont bien tenus durant la semaine et tiennent encore debout, mais John décline d’abord l’invitation.
Aux propositions (des textes non fictifs) des eugénistes (dont Churchill), favorables à la stérilisation des aliénés indigents, le Dr Fuller voudrait opposer son programme d’amélioration par la musique, la culture, et l’appuyer sur son expérience à Sharston, « un rapport sur les bénéfices de la musique et de la ségrégation à l’asile ». Frustré dans ses ambitions, il révélera un caractère ambivalent.
Clem explique les choses à Ella, les deux femmes travaillent à la blanchisserie. Tout le monde craint d’être envoyé au pavillon des chroniques d’où on ne sort pas, sinon pour le cimetière. Mieux vaut « être sage ». Clem, Clemency Church, aime citer Emily Dickinson ; de bonne famille, elle a échoué à l’asile après une grève de la faim pour échapper à un mariage imposé. Son père lui apporte régulièrement des livres. Clem aime la musique et apprécie que le Dr Fuller leur en joue. Elle rêve d’aller un jour à l’université.
La magnifique salle de bal deviendra l’endroit des retrouvailles entre Ella et John. Quand celui-ci se décide à lui écrire, elle peut compter sur Clem pour répondre – Ella ne sait pas écrire. Anna Hope raconte avec beaucoup de pudeur la manière dont ces personnages, malgré l’asile, trouvent l’un chez l’autre de quoi nourrir leur espoir d’une autre vie, de liberté. Ils en sont loin. Le règlement, le travail, les surveillants, les infirmières se mettent souvent en travers de leurs désirs. Et leur sort est entre les mains du Dr Fuller, aux humeurs changeantes. Aucun d’eux n’est à l’abri de grosses déceptions.
Dans une note en fin de volume, la romancière décrit l’asile de Menston dans le Yorkshire, où son arrière-arrière-grand-père a été patient à partir de 1909. La salle de bal est un beau roman qui voit émerger une improbable histoire d’amour dans cet endroit de misère sociale ou mentale, de promiscuité et de solitude.
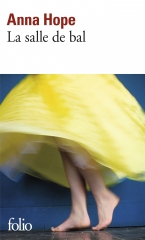 « Elle savait que Clem avait raison, qu’on laissait les gens sortir d’ici. Elle l’avait vu de ses propres yeux : la façon dont leur visage changeait quand elles savaient. Mais à présent, assise là dans la salle commune au fil des vendredis, à regarder les femmes se préparer, elle avait peur. La croyaient-ils toujours folle ? Qui connaîtrait les choses qu’elle avait en elle si elle restait dans cet endroit ? Elle n’avait personne pour prendre sa défense ici, nul être pour se faire son écho, rien pour expliquer qui elle était ou aurait pu être. »
« Elle savait que Clem avait raison, qu’on laissait les gens sortir d’ici. Elle l’avait vu de ses propres yeux : la façon dont leur visage changeait quand elles savaient. Mais à présent, assise là dans la salle commune au fil des vendredis, à regarder les femmes se préparer, elle avait peur. La croyaient-ils toujours folle ? Qui connaîtrait les choses qu’elle avait en elle si elle restait dans cet endroit ? Elle n’avait personne pour prendre sa défense ici, nul être pour se faire son écho, rien pour expliquer qui elle était ou aurait pu être. »


